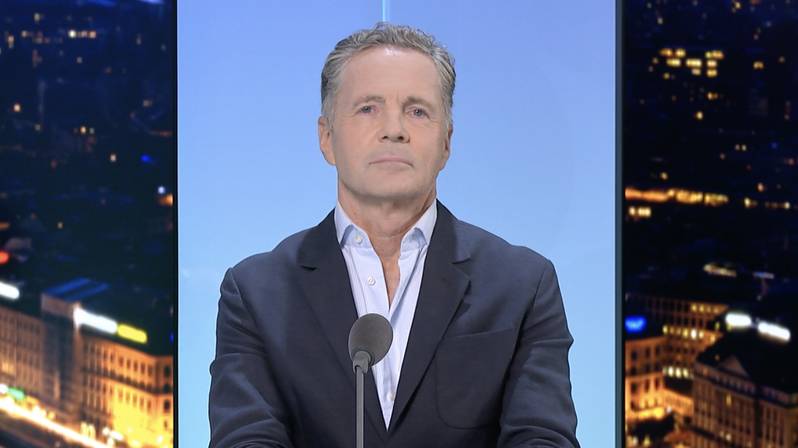La Croix-Rouge genevoise célèbre ses 160 ans

Fondée en 1864 par le Général Dufour à Genève, elle suit la constitution un an plus tôt du CICR par Henry Dunant. On lui doit la création de l’ancêtre de l’IMAD.
La section cantonale Croix-Rouge voit le jour en 1864, dans le sillage du **Comité international de la Croix-Rouge (CICR), fondé l'année précédente à Genève par Henri Dunant et d'autres figures importantes. Bien que la mission globale du CICR soit tournée vers les conflits armés internationaux et la protection des blessés de guerre, la section genevoise a rapidement vu l'importance d'intervenir localement pour répondre aux besoins de la population civile.
La Croix-Rouge genevoise a vu son rôle s'étendre au-delà des simples actions de secours en temps de guerre, en s'occupant des problèmes locaux notamment en matière de santé publique. Elle mettra sur pied les soins à domicile en 1889, créant ainsi l’ancêtre de l’IMAD.
«Présente dans l’urgence»
Durant les deux guerres mondiales, la Croix-Rouge genevoise a joué un rôle essentiel dans l’accueil des réfugiés, en particulier des enfants et des familles fuyant les zones de conflit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Genève, en tant que ville neutre proche des lignes de front, a vu affluer un grand nombre de personnes dans le besoin. La Croix-Rouge genevoise leur a offert «un accueil bienveillant et humain», rappelle Éric Mégevand, président de la Croix-Rouge genevoise.
Aujourd’hui, la Croix-Rouge genevoise veut «combler les lacunes quand l’offre fait défaut». Ainsi, les familles en difficultés, les enfants et les personnes âgées isolés, les jeunes en rupture scolaire et l’aide aux migrants sont accompagnés par la Croix-Rouge genevoise. L’institution dit «être là dans l’urgence», comme lors du Covid avec la distribution de 18'000 vaccins mais aussi l’accueil de réfugiés quelques semaines après le début du conflit ukrainien.
«La situation sur le plan budgétaire et financier est difficile. Les besoins augmentent tous les jours et nous avons terriblement besoin de l’aide de chacun», ajoute Éric Mégevand.